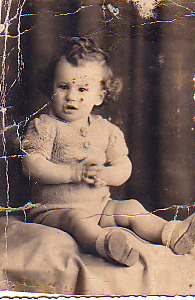Apports de la généalogie
La généalogie est à la
fois l’auxiliaire de nombreuses sciences humaines et une science
ayant son objet et ses méthodes propres. Elle se définit comme
l’histoire des origines et du développement des individus
groupés en famille.
Les lois de Mendel sur les caractères
héréditaires et la découverte, en 1952, par M. H. F. Wilkins, de
l’acide désoxyribonucléique (ADN) démontrent la transmission
chez l’homme de caractères physiques (taille, mode de
croissance, forme du corps et de ses parties, groupe sanguin) et
psychiques (caractère). Grâce au dépouillement de milliers de
généalogies, la vérification de ces théories a été rendue plus
facile en ce qui concerne les caractères physiques ; elle est
moins avancée dans le domaine des caractères psychiques et l’on
n’a quelque chance d’y parvenir qu’avec l’aide de la
graphogénéalogie, c’est-à-dire de l’analyse de l’écriture des
membres d’une famille. Tout Européen, ou tout Américain, a pour
ancêtres des Romains, des Huns, des Arabes ou des Israélites,
aussi bien que des Ligures, des Basques ou des Indiens. Il n’y a
pas de races pures, mais certains types psychiques et physiques
se rencontrent plus fréquemment que d’autres dans une nation
donnée. Les transmissions de ces types sont renforcées par les
mariages consanguins qui réduisent le nombre théorique des
ancêtres. Certains ancêtres reviennent plus souvent dans
l’ascendance. Ce sont les ancêtres « forts » qui fixent des
qualités ou des défauts dans une famille et font de chacun le
parent de millions de contemporains.
En médecine, en
démographie, en histoire, la généalogie a rendu d’appréciables
services. Ainsi la présence et la résurgence des tares
héréditaires (diabète, asthme, hypertension, épilepsie,
schizophrénie), dont la fréquence est due aux mariages
consanguins, rend indispensable la collaboration du médecin et
du généalogiste.
L’utilisation de tableaux d’ascendance et de
descendance fait progresser la démographie, lui apportant des
vues nouvelles sur la nuptialité, sur la fécondité, sur
l’émigration ou l’immigration et sur l’évolution des
populations.
La généalogie peut également aider à comprendre
le caractère des personnages historiques. Il est intéressant de
savoir que Turenne et Condé étaient des cousins issus de
germains ayant pour ancêtre commun le connétable Anne de
Montmorency. L’incompréhension dont a fait preuve Louis XVI à
l’égard du peuple français est-elle due au fait que sur ses
soixante-quatre quadrisaïeuls, huit seulement étaient français,
trente-quatre germaniques et seize polonais ?
Les tables
d’ascendance et de descendance font apparaître l’ampleur du
brassage social. Nullement figées, les classes ne sont pas la
juxtaposition d’individus ; elles sont formées de membres de
familles dont la place dans l’échelle sociale ne cesse de
varier.
Les sciences humaines ne peuvent étudier l’homme
indépendamment de l’histoire des familles ; la généalogie est
donc une science : elle rend compte aussi bien des caractères
dus à l’hérédité que de ceux qui sont acquis sous l’influence du
milieu dans lequel l’individu se forme dans sa jeunesse.
La
généalogie pratique
Le but de toute généalogie est d’établir
la table d’ascendance, la table de descendance et la table de
parenté d’un individu donné, c’est-à-dire la table de
descendance d’un de ses ancêtres, en ligne masculine ou
féminine.
Pour établir une table d’ascendance, on peut
employer la méthode verticale dite de l’arbre généalogique ;
utilisée par les Arabes, elle situe l’ancêtre en haut ou en bas
et les collatéraux sur les branches. Il existe également une
méthode circulaire, où l’ancêtre est placé au centre. Mais une
troisième méthode, dite horizontale, recueille à présent la
faveur générale .
Le repérage des ancêtres est facilité par
une numérotation, inventée en 1676 par Jérôme de Sosa et reprise
en 1898 par Stephan Kekule von Stradonitz. Cette méthode, dite
Stradonitz ou Sosa-Stradonitz, consiste à donner un numéro à
chaque individu : 1 à la personne dont on établit l’ascendance,
2 à son père, 3 à sa mère, 4 à son grand-père paternel, etc. Les
hommes ont toujours un numéro pair, les femmes un numéro impair.
Un père porte toujours un chiffre égal au double de celui de son
fils et à la moitié de celui de son père. Une mère porte un
chiffre égal au double plus 1 de celui de son fils, à la moitié
de celui de son père et à la moitié plus 1 de celui de sa mère.
Pour savoir à quelle génération appartient l’ancêtre n0 3554, on
cherche la puissance de 2 immédiatement inférieure à son chiffre
plus 1 : 211 = 2048 et 11 + 1 = 12e génération. Chaque puissance
de 2 correspond au nombre d’ancêtres d’une génération.
Le
tableau de descendance et de parenté peut être agnatique,
c’est-à-dire ne donner que les descendants portant le nom de
l’ancêtre ou le nom complet. Le tableau encombrant que l’on
obtient par la méthode verticale ou par la méthode horizontale
est actuellement remplacé par un tableau simplifié (cf. infra
l’explication des signes) :
Lazare Nicolas Marguerite Carnot
Z Sophie Dupont de Maringhem, d’où :
1. Sadi † s.p.
2.
Nicolas Léonard Sadi † s.p.
3. Lazare Hippolyte, qui suit.On
emploie la numérotation dite d’Aboville pour chaque personne :
elle porte, par rapport à un ancêtre donné, le numéro de
naissance de cette personne, 1, 2, 3, précédé du numéro de son
père, ou de sa mère, jusqu’à l’ancêtre. Ce système se combine
avec le tableau précédent et l’éclaire.
Cette numérotation
permet de classer rapidement les dossiers qu’il faut établir,
pour chaque personne, avec les copies de toutes les pièces
pouvant apporter des renseignements : actes d’état civil,
testaments, partages, passeports, actes d’acquisition ou de
bail, photographies, autographes, bulletins de paie,
déclarations d’impôts.
Les fiches sont le résumé du dossier
avec des signes spéciaux : O = né ; Z = marié ; † = décédé ; ) (
= divorcé ; s.p. = sans postérité ; s.a. = sans alliance.
Les
sources
Pour retrouver chaque filiation, chaque parenté, il
faut utiliser les témoignages oraux – pour les contemporains – ,
les registres d’état civil, les archives des notaires, ainsi que
les archives nationales et départementales. En France, le
registre d’état civil créé en un seul exemplaire, depuis 1539,
et en double depuis 1579, était tenu avant 1792 par le clergé
catholique : généralement, un des exemplaires est aux archives
de la commune et l’autre aux archives départementales. Depuis
1792, les registres sont tenus par les municipalités, qui en
gardent un exemplaire, l’autre étant confié au greffe du
tribunal de grande instance. Il n’existe pas de table nationale,
ni, sauf à Paris de 1792 à 1862, de table départementale. Les
tables communales sont décennales. L’état civil des Français
vivant à l’étranger est conservé au ministère des Affaires
étrangères, celui des Français vivant dans les départements
d’outre-mer à la section Outre-Mer des Archives nationales. En
France, les actes d’état civil concernant les réformés ou les
israélites sont rares avant 1792. Les autres pays ont adopté
avec quelque retard le système français. Certains, comme les
Pays-Bas et la Suède, tiennent un dossier national par individu.
La Suisse possède des dossiers par commune d’origine.
Les
archives des notaires sont en grande partie entre les mains des
notaires, sauf à Paris, où elles sont rassemblées aux Archives
nationales, et dans certains départements. On peut se servir,
pour les recherches, des archives de l’enregistrement, des
archives départementales, ou des répertoires des notaires. À
l’étranger, ces documents existent aussi, surtout dans les pays
latins.
Les Archives nationales et départementales renferment
les dossiers de presque tous les fonctionnaires et ceux des
personnes qui ont reçu des distinctions honorifiques. En France,
le ministère des Armées et celui des Affaires étrangères
conservent les dossiers concernant leur personnel. Les pays
étrangers possèdent le même type de documents.
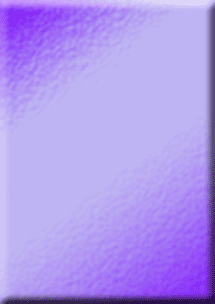


.gif)


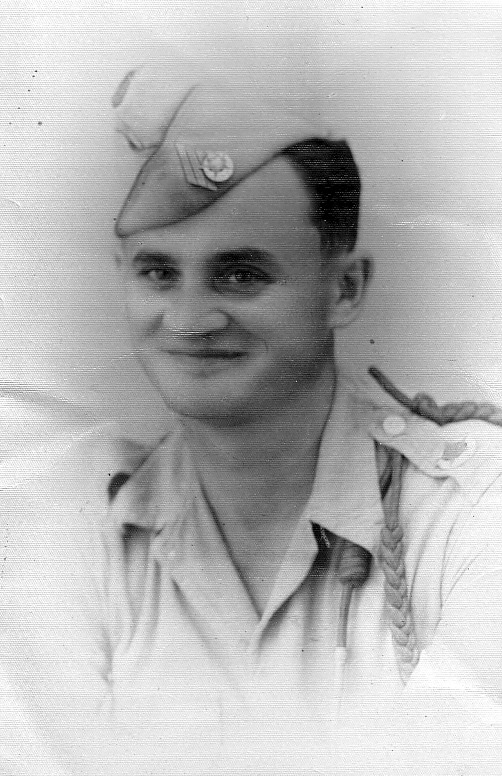

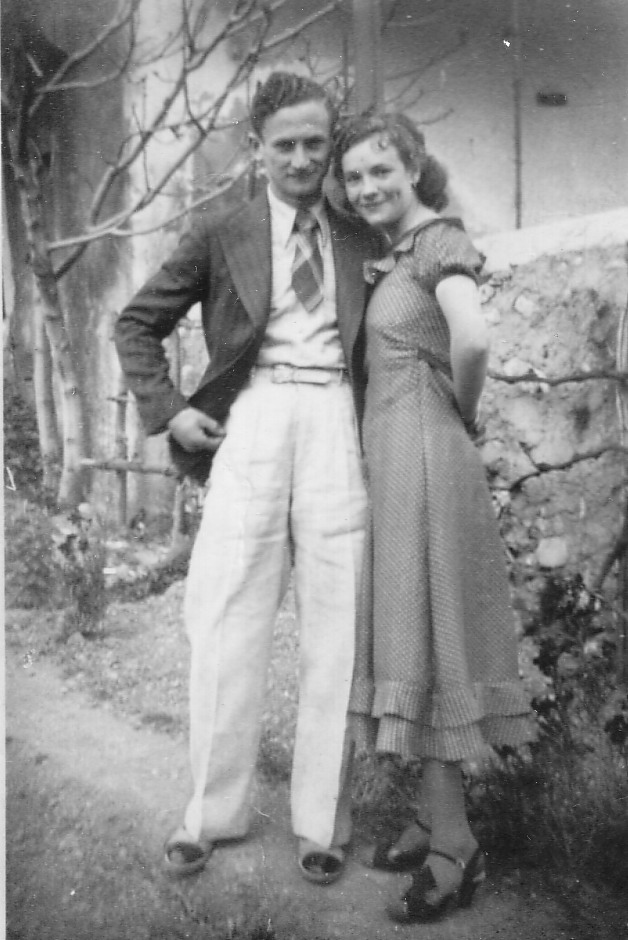

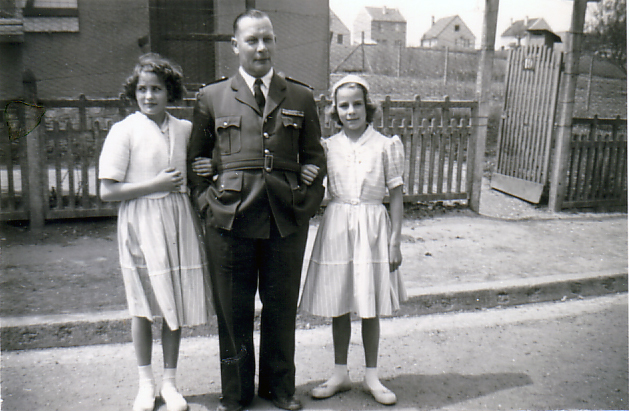 l
l